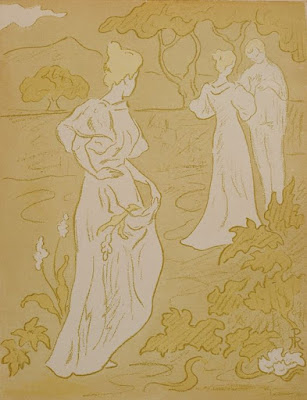Les Européens du Nord aiment bien passer leurs vacances dans les pays du "Club Méd", même s'ils considèrent leurs ressortissants avec condescendance : des gens pas sérieux, bordéliques et oisifs. La psychologie des peuples ou la société de confiance, ça alimente, en effet, largement les conversations "économiques" des dîners en ville. On a complétement oublié que tous ces pays (Grèce, Espagne, Italie, Portugal) ont exercé, autrefois, une domination mondiale.
L'Espagne de Charles Quint a ainsi constitué, au début du 16 ème siècle, la première puissance politique, économique, culturelle européenne et même, au-delà, le premier Empire planétaire.
Et puis, on s'est rendu compte, aux alentours de 1660, sous Philippe II, le successeur de Charles Quint, que quelque chose n'allait plus, que la machine se déréglait. Un lent appauvrissement généralisé, une misère populaire accrue contrastant avec l'existence somptuaire et luxueuse de la noblesse. C'était le début d'un déclin qui allait se poursuivre jusqu'au 20 ème siècle.
On sait aujourd'hui expliquer le déclin de l'Empire Espagnol. C'est le moteur de son esprit de conquête, de son expansion, qui lui a, en fait, inoculé un poison mortel : la soif de l'or, cet or supposé générer automatiquement richesse et prospérité. Sitôt la conquête des Amériques effectuée, les galions espagnols ont importé d'immenses quantités d'or et d'argent. Durant les premières décennies du 16 ème, la quantité d'or et d'argent en circulation en Europe aurait ainsi plus que triplé. C'était la première expérience de l'argent magique, expérience instructive mais dont on s'est empressés d'oublier les leçons.

L'Empire des Habsbourg s'est cru tout à coup colossalement riche. Et fortes de cet afflux d'or, les classes possédantes ont alors consommé avec frénésie des objets de luxe (de la soie, de la porcelaine, des miroirs, des épices) importés, à grands frais, de Chine et d'Asie. Mais dans le même temps, les prix se sont progressivement envolés, ruinant l'agriculture et l'activité manufacturière. Et d'ailleurs qui avait envie d'investir dans une activité productive alors qu'il était beaucoup plus intéressant, pour devenir riche, d'affréter un quelconque navire pour rapporter, d'un pays lointain, de l'or ou des épices ?

Mais tu nous casses les pieds avec Charles Quint et les Habsbourg, c'est du passé, on s'en fiche, allez-vous me dire. Oui ! Mais si j'en parle, c'est parce que j'ai l'impression qu'en matière économique, on vit à nouveau aujourd'hui dans l'Empire espagnol du 16 ème siècle en continuant d'en partager toutes les illusions. Certes, on est devenus modernes, la monnaie est devenue largement électronique et surtout, on a bazardé, en 1971, l'étalon or que l'on a irrémédiablement rangé dans la catégorie des vieilleries fétichistes. On ne s'intéresse d'ailleurs plus à la monnaie réelle, concrète, mais à ses supports de transmission : ça a enfanté tous les "gogos" qui spéculent sur le "bitcoin", les SPAC (ces "coquilles vides" à la mode, servant de véhicules d'investissement), les options sur indices, les SWAP.
Le point culminant du système, c'est qu'on peut en outre, grâce à la fixation administrée des taux d'intérêt, emprunter à un taux voisin de zéro. Plus besoin de contrepartie, de limite, à la croissance de la masse monétaire.
Les banques centrales et les banques commerciales disposent aujourd'hui de quasiment toute liberté et elles peuvent s'en donner à cœur joie, accroître à loisir l'émission monétaire. On est ainsi devenus des Espagnols de la Renaissance parce que l'on partage deux idées liées : d'une part, on serait riches parce que l'on dépense (on consomme) et qu'importe si ce que l'on achète n'a à peu près aucune utilité sociale; d'autre part, la richesse d'un pays dépendrait de la quantité de monnaie qui y circule et à cette fin, il ne faudrait pas hésiter à recourir au déficit budgétaire et à son financement par l'emprunt.

La "réussite" est d'ailleurs totale en ce dernier domaine même si elle donne le vertige : la masse monétaire a ainsi triplé en volume, au cours de ces dernières années, en Europe et aux Etats-Unis. On sait bien, malheureusement, que la croissance économique n'a pas suivi la même pente ascendante. On s'étonne simplement de ne pas constater davantage d'inflation. Mais en fait, il y a au moins une inflation immobilière, financière et "artistique". Et au-delà de ces trois secteurs, le solde de la demande en excès vient alimenter l'économie chinoise, entretenant, avec elle, d'énormes déficits commerciaux.
On pratique maintenant ce que l'on appelle la "politique de l'hélicoptère", comme si on déversait directement sur les populations, depuis un hélicoptère, des masses énormes de billets de banque. C'est ce que fait, en particulier, Joe Biden, avec ses petits chèques adressés à la plupart des ménages américains.

La vénération portée à Joe Biden est telle que personne n'ose crier au fou. Moi-même, je le trouve très humain et très sympathique mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il est un pompier pyromane, déversant ses jerricans d'essence sur une économie américaine déjà en surchauffe. Il est prisonnier de cette idée que Trump avait laissé l'économie dans un état catastrophique. Du reste, les Américains commencent à s'inquiéter eux-mêmes, à se dire que quelque chose ne tourne pas rond. La preuve, leur taux d'épargne vient d'atteindre des montants inédits. Sage attitude, en fait, qui évitera peut-être que les torrents de dollars du plan américain n'aillent s'évaporer en Chine ou dans des mirages financiers.

Il est vrai que l'Europe n'est pas en reste et s'apprête elle-même à amorcer sa "pompe à Phynances" à grands coups d'emprunts. Tant pis d'ailleurs si ces endettements conjugués de l'Europe et de l'Amérique vont accroître l'écart entre pays riches et pays pauvres en siphonnant les capacités d'emprunt mondiales. Pour se sortir des dégâts du Covid, les pauvres attendront.
On va donc se lâcher, c'est le "quoi qu'il en coûte" devenu tellement populaire, comment n'y avait-on pas songé avant ? Je préfère ne rien dire parce que je sais que la crise sanitaire a généré des millions d'experts : en épidémiologie d'une part, en économies-finances d'autre part. Mais nul n'est prêt à admettre que les lanternes qu'il agite en ces matières ne sont peut-être que des vessies.
Je ferai part quand même de deux exaspérations :
- j'en ai marre d'entendre des "experts économiques" (ceux des médias français notamment) espérer fiévreusement une relance de la consommation dite "populaire". On nous incite fortement à dépenser, faire chauffer notre carte bancaire, aller au restaurant, au café, faire les soldes, se faire plaisir, prendre du bon temps. C'est ce qui ferait marcher l'économie. Hors de la consommation, il n'y aurait point de salut. On se désole même de constater que l'épargne des Français a significativement progressé durant la crise sanitaire. On nous culpabilise presque à ce sujet. C'est mal, il faut vite dégonfler ça ! Avoir de l'épargne, c'est jugé, à la limite, une attitude anti-citoyenne.

L'épargne, aux yeux de ces experts, ça apparaît comme l'ennemi absolu de la croissance économique, ce qu'il faudrait même proscrire radicalement. Le malheur, c'est qu'à peu près tout le monde se range à cette "opinion". Pourtant, allez faire un tour à Moscou ou même à Téhéran. Vous y constaterez que là-bas aussi, la consommation, ça marche très fort: les magasins de luxe sont éventuellement plus nombreux et parfois même plus beaux qu'à Paris. Quant à la façon dont les filles sont habillées, l'élégance de leurs vêtements, il n'y a pas photo. Et que dire du parc automobile avec sa multitude de berlines allemandes haut de gamme. Quant aux babioles électroniques (ordinateurs chinois, smartphones coréens, écrans Oled) elles sont aussi largement aussi répandues ? En contrepoint, partez ensuite à Copenhague ou à Stockholm : peu de belles bagnoles, encore moins de magasins ou de restaurants de luxe et des filles dont la tenue est plutôt négligée. Allez-vous en conclure que la Russie est beaucoup plus riche que le Danemark ou la Suède ? En fait, vouloir développer la consommation à toute force, comme on s'y emploie aujourd'hui, c'est avoir une vision
de pays sous-développé. L'empire espagnol nous instruit à ce sujet : la consommation, c'est ça, en réalité, qui dévore
les pays pauvres en embolisant toutes leurs ressources disponibles.

On déteste tellement les banques qu'on est incapables de reconnaître leur rôle essentiel dans une économie. L'Union Soviétique a cru pouvoir s'en passer, on a vu le résultat. Le footballeur et grand économiste, Eric Cantona, a même un jour décidé de retirer tout son argent de sa banque. On croit, en fait, qu'une banque se contente de conserver précieusement, dans un coffre-fort, les petits sous qu'on lui confie. En réalité, elle se dépêche de recycler les fonds déposés (notre épargne) à des fins d'investissement : immobiliers, financiers, participations en capital. Ce recyclage dans l'investissement a, en fait, un impact économique considérable (sauf s'il se porte sur des produits financiers). On estime que l'effet de levier d'un euro déposé dans une banque est quatre fois supérieur à celui du même euro gaspillé dans la consommation. C'est pour ça que les pays les plus riches sont ceux qui ont la plus forte épargne parce que l'épargne, ça se traduit en investissements et en développement à long terme.

Mais c'est pour ça aussi que le Plan de Joe Biden, centré sur la consommation, est alarmant (le Plan européen échappe heureusement, en partie, à cet écueil). Quant à la France, elle est convaincue d'avoir une épargne gigantesque. C'est vrai en valeur absolue mais, malheureusement, cette belle épargne française est complétement siphonnée, et au-delà, par l’État pour le financement de sa dette. Ça explique la panne de l'investissement et le "déclin français".

- Ce constat me permet d'embrayer sur une autre "idée reçue" qui m'irrite profondément. Tout le monde semble désormais s'accommoder de cette idée que pour surmonter la crise actuelle, il ne faudrait pas hésiter à s'endetter davantage. On milite même pour une suppression de tout plafond. Pour montrer qu'on est un expert, qu'on n'est pas complétement irresponsable, on exprime toutefois, sentencieusement, une inquiétude : "l'inconvénient, c'est qu'on reporte sur nos enfants la charge de notre dette; ce sont eux qui vont en baver, on se conduit, finalement, en égoïstes".
On ne peut pas avoir une conversation sur la dette sans que soit ressassé ce cliché : celui de la génération future sacrifiée. C'est désormais partout admis comme une évidence et personne ne semble s'aviser de ce que c'est peut-être une "ânerie". Il faut croire que les adultes, aujourd'hui, entretiennent une étrange culpabilité vis-à-vis de leurs enfants pour développer des idées si complaisantes.
Moi, je tiens à rassurer tout de suite : nos "chères têtes blondes" n'auront pas à payer les conséquences de nos errements passés parce que les conséquences, on les paie dès aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez bien que lorsque vous contractez un emprunt, votre banquier vous en demande un remboursement, en intérêts et en capital, dès le premier mois et non pas dans 10 ans ou dans 20 ans.
En réalité, la dette publique ne réalise pas un transfert d'une génération à une autre, des vieux vers les jeunes, mais un transfert entre ceux qui paient des impôts, les contribuables, et ceux qui placent leur argent en titres de la dette publique et reçoivent des intérêts.
Cela signifie que l'endettement de l’État se traduit par une diminution des ressources de ceux qui sont assujettis à l'impôt et, simultanément, par une augmentation des revenus des rentiers.
Il s'agit donc d'une redistribution, non pas entre générations, mais entre groupes sociaux, des cigales aux fourmis et même des pauvres vers les riches. En réalité, l'endettement de l’État accroît les inégalités sociales et il est, à cet égard, curieux de constater que ce sont les partis "de gauche" qui sont les plus favorables à la dette. Et puis inutile d'ajouter que les dépenses de l'Etat, financées par ponction sur le revenu national, ne contribuent à peu près rien à l'accroissement de la richesse d'un pays.
On vit maintenant, au total, dans un monde d'illusions, de mensonges, de rois faux-monnayeurs persuadés que la quantité d'argent magique est potentiellement infinie. La monnaie est devenue virtuelle et on a complétement perdu de vue qu'elle correspondait d'abord à une production, une richesse matérielle concrète (qu'elle a simplement pour fonction d'échanger) et à un travail mobilisé. On est vraiment des Espagnols du 16 ème siècle.
Tableaux de Georgia O'Keeffe (1887-1986), peintre moderniste américaine que j'aime beaucoup.
Un long post (mais comment faire autrement ?) qui va sans doute irriter et probablement ennuyer. Mais je rappelle que j'avais initialement envisagé de créer un blog pédagogique traitant d'économie.
Dans le prolongement de ce post, je recommande :
- Stéphanie KELTON : "Le mythe du déficit". Je trouve ça indigent mais j'en conseille quand même la lecture (rapide). Stephanie Kelton est en effet une "figure" de la nouvelle théorie monétaire moderne américaine (la TMM). Elle aurait inspiré Bernie Sanders en faisant l'apologie du déficit budgétaire, de la dette et des dépenses publiques. C'est très bavard, mêlant même des anecdotes personnelles, et peu technique; bref, c'est très américain. C'est bizarre: elle ne parle que des Banques Centrales et de la Réserve Fédérale, mais l'économie réelle, les banques commerciales, les entreprises, elle ne semble pas connaître.
- Jean-Marc DANIEL : "Il était une fois ...L'argent magique". L'exact contrepoint de Stéphanie Kelton. Un modèle de concision, précision, pertinence. Excellent.
Et enfin, un très grand livre qui m'inspire beaucoup :
David RICARDO : "Des principes de l'économie politique et de l'impôt".
C'est curieux. Même dans les grandes écoles, on n'enseigne pas l'économie en faisant lire les grands économistes (sauf peut-être Karl Marx, mais est-il un économiste ?). On fournit plutôt des manuels indigestes. C'est sans doute dommage parce que les "classiques" ont une qualité de pensée et d'écriture inégalable.